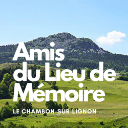Villelonge et les parachutages de l’été 1944, par Jean-Pierre Verroul
Bonjour à toutes et à tous.
Pour vous pré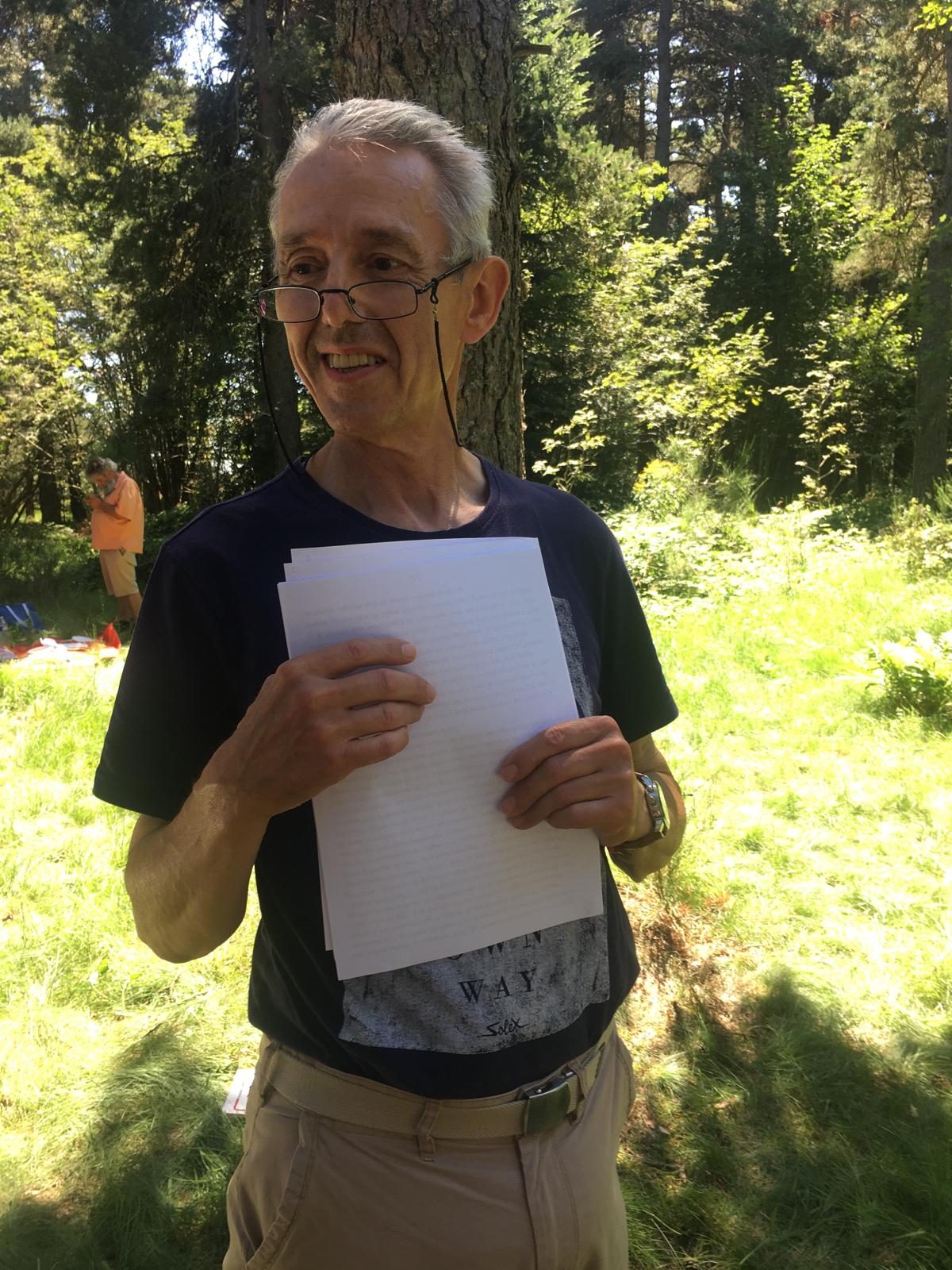 senter ce sujet sur « Villelonge et les parachutages de l’été 1944 » et en souligner son intérêt, deux citations m’ont paru particulièrement pertinentes.
senter ce sujet sur « Villelonge et les parachutages de l’été 1944 » et en souligner son intérêt, deux citations m’ont paru particulièrement pertinentes.
La première est celle de l’historien Fabrice Grenard, spécialiste de la Résistance : « La réception d’un parachutage représente un moment marquant de la vie au maquis » […] et qui déclenche « une grande euphorie ».
La deuxième est celle de Christian Dissandro, maquisard FTP en haute Ardèche, montant en camion depuis Lamastre avec d’autres maquisards pour réceptionner un parachutage sur le plateau ardéchois, au pied du Mont Gerbier de Jonc. « L’événement est très important. Il prouve notre liaison avec la France libre, nous savons maintenant que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ; avant cet événement, nous parlions de parachutages comme les enfants s’entretiennent du père Noël. […] [Dans le camion,] certains parlent de paquets de cigarettes, de ballots de tabac, d’armement perfectionné, mitraillettes, fusils mitrailleurs, grenades, postes radio et tant d’autres choses que nous espérons découvrir. Notre bonheur paraît si grand que par instant, nous doutons de sa réalité. »
Il faut effectivement avoir à l’esprit que les maquis, dont les effectifs sont en forte augmentation à partir du printemps 1944, sont dénués de presque tout : des armes et des munitions qui soient en quantité suffisante, mais aussi des chaussures, des vêtements, des médicaments, des vivres et pour les fumeurs, on l’a vu, du tabac. D’où cette idée de « manne céleste » que représentent les parachutages.
I) Présentation des parachutages de l’été 1944 sur le Plateau.
1) Le cadre spatial et chronologique
Dans quel cadre spatial et chronologique se déroulent les parachutages ?
a) - Le cadre spatial ou « géographique » = la partie du Plateau située entre Fay-sur Lignon, Saint-Agrève, Devesset, Le Chambon-sur-Lignon et Le Mazet-Saint-Voy.
b) - Le cadre chronologique ou les limites de ce que l’on entend ici par le terme « été 1944 » = la période qui s’étend de la mi-juin 1944 à la mi-septembre 1944. (Du 15 juin au 11 septembre pour les dates précises).
2) Les différents parachutages de l’été 1944.
a) - Où ont eu lieu les parachutages et combien en a-t-on dénombré ?
À Devesset (à l’emplacement du lac actuel) : 12 parachutages.
À Lichessol (4 km au Sud-Est de Saint-Agrève, c’était le terrain de secours pour Devesset) :1 parachutage.
À Villelonge : 20 parachutages.
Aux Chazallets : (à 4 km d’ici) : 1 parachutage.
À Senicroze : (2 km au Sud de Fay-sur-Lignon, en direction de Saint Clément) : 1 parachutage.
Près du hameau de Hugons : (c’était le terrain de secours pour Villelonge, à 2.5 km d’ici). Il aurait dû y avoir un parachutage le 8 septembre 1944, mais celui-ci n’a pas eu lieu car l’avion attendu cette nuit là ne s’est pas présenté.
Au total : 35 parachutages sur le Plateau en 1944 contre 2 au cours des deux années précédentes (1 en 1942 et 1 en 1943). Le contraste est saisissant : 95% des parachutages sur le Plateau ont lieu en 1944 (et plus précisément entre avril et septembre) contre 5% pour les deux années précédentes. Ce qui ne distingue pas pour autant le Plateau du reste de la France. Car, pour l’ensemble de la France, 93.5 % des containers sont parachutés en 1944 contre 6.5 % pour les trois années 1941, 1942 et 1943. On remarquera enfin qu’avec 20 parachutages sur 35, le terrain de Villelonge concentre la plus grande partie des parachutages sur le Plateau (environ 60%). (57.1% exactement).
Pour des raisons de sécurité les parachutages sont effectués de nuit, mais il y a eu probablement quelques parachutages de jour, malgré les dangers que cela représentait. Combien exactement (?) : on l’ignore, mais en tout cas, au moins un a eu lieu de jour : il a été effectué en août 1944, sur le terrain de Devesset, et photographié par Roger Darcissac, directeur de l’école publique du Chambon-sur-Lignon.
c) - Dans le contexte de ces mois de juin, juillet, et août 44, deux éléments importants sont à souligner au sujet des parachutages :
1°) L’appui financier : des sommes d’argent importantes en billets sont parachutées avec le matériel. Elles permettent l’entretien des troupes du maquis. (On pense notamment au ravitaillement). Elles permettent aussi d’aider les familles des résistants qui sont dans le besoin.
2°) Les mesures de précaution à prendre, car la répression de la milice et de l’armée allemande est féroce et elle s’intensifie. Lors des opérations de parachutage, il faut donc assurer la surveillance du terrain et la sécurité des personnes présentes. Il faut aussi éviter d’attirer des représailles sur la population civile.
3) Quelques précisions sur l’organisation, les moyens matériels et humains
a) - Le choix du terrain et son homologation.
- C’est l’objet de la venue de Virginia Hall au Chambon le 14 juin 1944. Elle visite le 15 juin 1944, avec Pierre Fayol, Désiré Zurbach et Hubert Petiet les terrains possibles repérés par les résistants. (Ils se déplacent tous les quatre avec la traction avant réquisitionnée de Pierre Fayol). Le terrain doit être une étendue herbeuse d’environ 800 m de long par 400 m de large. Il doit se trouver dans un lieu discret, si possible à proximité d’un bois qui pourra cacher le comité de réception. Il doit aussi se trouver près d’une route plutôt que d’un chemin pour pouvoir transporter rapidement le matériel parachuté, mais cette route ne doit pas être trop fréquentée. Il faut éviter de se trouver à proximité d’une route à grande circulation (come la D15 en direction de Saint-Agrève par exemple).
- Une fois choisi, le terrain doit être homologué. Cela consiste à communiquer ses coordonnées aux services alliés qui vont le répertorier. Ensuite, à lui donner un nom de code, plus un message à diffuser par la BBC pour annoncer le parachutage et enfin une lettre de reconnaissance à émettre en morse avec une lampe, à destination de l’équipage de l’avion. Pour le terrain de Villelonge, le nom de code qui sera attribué sera le mot anglais « Bream » (qui correspond en français au nom du poisson : la brème). Le message sera : « Cette obscure clarté qui tombait des étoiles » et la lettre : « R » (un point, un trait, un point en alphabet morse).
Précisons qui est Pierre Fayol : c’est un militaire démobilisé en 1940, issu d’une famille juive. Son véritable nom est Lévy. Il vit à Marseille jusqu’en novembre 1942 avant de se réfugier avec son épouse et son fils, à la Celle près du Chambon-sur Lignon (où des cousins étaient déjà venus se réfugier). Mis en relation avec Léon Eyraud, chef de la Résistance locale, il devient responsable de l’action militaire pour le secteur d’Yssingeaux puis chef départemental adjoint des F.F.I. Après les combats du Mont Mouchet du 10 et 11 juin1944, il réorganise le maquis de l’Yssingelais.
b) - le matériel utilisé : avions et containers.
Pour parachuter à la Résistance le matériel et les équipements nécessaires, les alliés utilisent des bombardiers « lourds » quadrimoteurs, car ce sont à l’époque les seuls avions qui ont les caractéristiques requises pour effectuer ce type de mission en termes de tonnage et de distance. Ces bombardiers sont soit des Halifax (anglais), soit des Boeing B 17 (américains) (appelés aussi « forteresses volantes »). Les containers ont été conçus pour être rangés et arrimés dans les soutes à bombes, d’où leur forme cylindrique. Les avions partent de l’Angleterre, mais aussi de l’Algérie où les Américains ont installé des bases aériennes après le débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord.
Différents modèles de containers ont été produits pendant la guerre. D’une manière générale, un container est un cylindre de 1.80 m de long et 40 cm de diamètre, fabriqué le plus souvent en tôle. Les containers sont destinés principalement à l’acheminement des armes, des munitions et des explosifs. Une
remarque : un reste de container parachuté sur le terrain de Devesset est exposé à l’entrée de la salle de la gare, au Chambon-sur- Lignon.
Trois précisions :
1°) Tous les containers ne sont pas en tôle. Il y a eu des fabrications en carton toilé rigide de 8 mm d’épaisseur, afin d’économiser le métal, considéré comme matériau stratégique.
2°) Tout n’est pas mis dans des containers. Certains équipements comme par exemple les radios, le matériel médical sont rangés dans des caisses spécialement conçues en grillage toilé ou en osier tressé (de la taille d’une petite cantine métallique). Ces caisses sont appelées colis ou paquets (« packages » en Anglais) et sont parachutées en nombre variable (de 1 à 10) en plus des containers.
3°) Le poids : un container en tôle une fois rempli est lourd : 40 kg à vide et 110 à 120 kg de charge. (Le poids total de 160 kg est le maximum à ne pas dépasser par rapport à la résistance de la voilure du parachute). Les containers sont munis de quatre poignées et il faut 4 personnes pour les soulever et les transporter. À raison de 12 ou 15 containers par avion, il est donc nécessaire de prévoir beaucoup de personnes afin de pouvoir récupérer le plus rapidement possible les containers arrivés sur un terrain.
c) – Les moyens humains : un personnel majoritairement masculin, mais une présence féminine dont le rôle est très important.
- À la fin juin 1944, à la suite du retour des groupes qui ont combattu au Mont Mouchet, le commandant Pierre Fayol, réorganise ses effectifs de maquisards.
D’une part, il constitue trois compagnies Y1, Y2 et Y3 (le Y signifiant Yssingeaux). D’autre part, suivant les consignes des instances de la Résistance, mais aussi celles données par Virginia Hall, il crée la compagnie YP (pour Yssingeaux Parachutages). Spécialement chargée de réceptionner les parachutages prévus en assez grand nombre, cette compagnie YP va rester basée à Villelonge (et autour de Villelonge), alors que les compagnies Y1, Y2, et Y3 vont aller s’installer au château de Vaux près de Retournac (pour surveiller et contrôler la vallée de la Loire).
- Raoul Le Boucicaut (pseudo : Bob) est chargé par Pierre Fayol de la formation et du commandement de la compagnie YP. Il devient également responsable de la réception des parachutages et de la protection des terrains. Agé de 24 ans en 1944, il est particulièrement qualifié pour cette mission en raison de sa formation militaire. Engagé très jeune dans l’armée française, il s’est engagé à nouveau après la défaite de 1940, dans les Royal marines en Angleterre. En 1942, il a intégré les services secrets anglais (l’Intelligence Service) où il a été formé entre autres au chiffrage des messages, à la radio et la transmission en morse. Arrivé sur le Plateau en août 1943, il a pris la succession de Pierre Brès (pseudo « Naho ») en octobre 1943 à la tête des groupes maquis de Villelonge.
- L’effectif de cette compagnie YP compte une trentaine de jeunes maquisards cantonnés dans deux fermes à proximité de Villelonge : 22 hommes à la ferme des Suchas (à 2 km de Villelonge en allant vers les Chazallets) et 7 hommes à la ferme des Pignes, dite aussi « le Poulailler » (à1km de Villelonge en allant vers l’Est). On peut citer parmi eux quelques noms : Désiré Zurbach et Edmond Lebrat qui vont être détachés pour aider Virginia Hall, Serge Nelken, Jacques Coutarel, le frère d’Alfred Roger Coutarel et, bien sûr, Gabriel Eyraud du Chambon-sur-Lignon qui a beaucoup témoigné sur cette période. Raoul Le Boucicaut peut compter aussi sur 45 autres résistants résidant chez eux et pouvant se rendre disponibles en cas de besoin. Il va également proposer à d’autres jeunes de venir aider au ramassage, comme Olivier Hatzfeld ou Alfred Roger Coutarel. Pour ramasser les containers, Raoul le Boucicaut constitue des équipes de cinq jeunes, dont un chef d’équipe. Chaque équipe doit ramener cinq containers au point de rassemblement prévu pour tous les containers.
Ce monde est majoritairement masculin, mais il ne faut pas oublier que quatre femmes vont jouer un rôle fondamental dans la réception des parachutages:
1) - Virginia Hall,
2) - Léa Jouve-Lebrat, dont le mari est prisonnier en Allemagne,
3) - Jacqueline Decourdemanche, dont le mari a été fusillé par les Allemands en 1942.
4) - Marianne Fayol, épouse de Pierre Fayol.
II) Un exemple : le parachutage dans la nuit du 11 au 12 juillet 1944 sur Villelonge.
À partir des récits des personnes y ayant participé et de la documentation que j’ai pu consulter, j’ai tenté de reconstituer les événements qui se sont déroulés ici, sur ce terrain, à l’occasion du premier parachutage, lequel est, bien évidemment, celui qui a laissé le souvenir le plus marquant.
=> Que s’est-il passé ici au cours de la soirée et de la nuit du 11 au 12 juillet 1944, entre 21h00 et 03h00 du matin environ ?
Aux alentours de 21h30, ce mardi 11 juillet 1944, de nombreux maquisards, résistants et résistantes commencent à se rassembler sur ce terrain de Villelonge dont les limites ont été décrites par Alfred Roger Coutarel : « terrain qui couvrait plusieurs dizaines d’hectares, très exactement limité par l’épicerie Debard, la route le Chambon-sur-Lignon / les Vastres (la D7) et le lit encaissé d’un petit ruisseau, le Lioussel, dont le confluent avec le Lignon vellave est situé en amont du pont de Mars en Ardèche ». (Remarque : l’épicerie est tenue par Madame Léa Debard, qui a quatre filles : Edith, Edmée, Denise et Aliette. La salle de classe où enseigne Edith qui est institutrice se trouve au rez-de-chaussée de la maison).
Pas très loin d’ici, à 6 kilomètres à vol d’oiseau, un peu à l’écart de la route qui va du Mazet-St-Voy à Tence (la D 500), se trouve la ferme du Riou, où se sont installés récemment Pierre et Marianne Fayol, et où ils hébergent pour quelque temps (une semaine) Virginia Hall (pseudo : Diane). C’est depuis cette ferme du Riou que Virginia Hall a codé puis transmis à la station radio de Grendon Underwood, en Angleterre, les messages concernant la commande de matériel et les modalités d’organisation de ce premier parachutage. Cette station, à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Ouest de Londres, reçoit tous les messages codés en provenance de la France et renvoie tous les messages codés à destination de la France.
Afin d’aider Virginia Hall, Marianne Fayol écoute les messages qui sont émis en clair par la BBC de Londres sur un tout petit poste récepteur, facile à dissimuler. (Il s’agit de la fameuse émission « les Français parlent aux Français »). Le11juillet, à 13h00, elle entend le message « cette obscure clarté qui tombait des étoiles ». Ce message, s’il est repris à 17 heures et à 21 heures, annonce le lancement de l’opération. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire que le parachutage est annulé. À 17 heures, le message est répété. Le soir à 21heures, Marianne et Pierre Fayol, attentifs, sont à l’écoute et entendent à nouveau « Cette obscure clarté qui tombait des étoiles ». Le message est suivi de la phrase « Je dis trois fois ». Ce sera donc pour cette nuit, à Villelonge, et « trois fois » veut dire qu’il y aura trois avions. L’heure a été convenue à l’avance dans les messages codés : aux environs de 1h 30 du matin.
Sur le terrain vont alors arriver par petits groupes une soixantaine de personnes dont la présence est nécessaire pour effectuer toutes les tâches à accomplir : le balisage, les communications, le ramassage, le transport et le stockage, mais aussi la surveillance du terrain en cas d’arrivée inopinée d’éléments suspects (personnes ou véhicules). Afin de parer à cette éventualité, Marianne Fayol a confectionné peu de temps auparavant et en toute hâte des brassards avec les lettres F.F.I et la croix de Lorraine imprimés à la pomme de terre, brassards que portent exclusivement celles et ceux qui participent à la réception du parachutage. De cette manière, toute personne étrangère au parachutage ou tout intrus suspect sur le terrain peut être repéré et arrêté. Le balisage du terrain se met en place : vu du ciel, il a la forme d’un immense Y. À chaque extrémité du Y se tiendra une personne qui allumera une lampe blanche fixe. Au centre du Y ce sera une lampe blanche clignotante qui sera allumée. Cette lumière clignotante a pour fonction d’indiquer le point de largage et de confirmer l’identité du terrain en émettant trois éclats lumineux (un bref, un long, un bref) correspondant à la lettre « R » en alphabet morse (un point, un trait, un point). Ces signaux lumineux seront effectués avec des torches électriques dont la portée n’est pas très importante. Dans le cas où ces signaux ne seraient pas repérés par les aviateurs, des fagots et de la paille ont été prévus et seront enflammés si nécessaire.
Il est 22h00 ici (heure allemande), mais aussi 22h00 en Angleterre. (Car depuis le printemps 1944, le Royaume-Uni est passé à GMT + 2). Sur la base aérienne de High Wycombe, à 50 km à l’ouest de Londres, et pas très loin de Grendon Underwood, trois forteresses volantes B17 de la 8th Air Force américaine décollent. Dans les soutes à bombes ont été arrimés les containers et les colis qui contiennent la commande de Virginia Hall. Les avions mettent le cap plein Sud, direction la France. Arrivés en vue de la Manche, ils survolent la pointe de Selsey Bill, un peu à l’est de l’île de Wight, et obliquent en direction de Ouistreham en Normandie. Dès lors que les trois avions franchissent les côtes françaises et pénètrent en territoire considéré comme ennemi, c’est le silence radio total afin de ne pas être repéré. Pour atteindre Villelonge, il reste encore 2 heures 15 de vol environ Dans les trois avions, l’âge moyen des jeunes hommes qui composent les équipages n’est guère plus élevé que celui des jeunes garçons de la compagnie YP qui les attendent. Dans l’avion de tête, le navigateur trace sur sa carte le cap à suivre. Il arrête son trait sur le point de destination qui lui a été communiqué (45 degrés Nord – 4 degrés 17 Est). Le point de repère visuel qui lui a été fourni en cas de besoin est le Mont Mézenc. La nuit est une nuit de pleine lune. C’est la situation la plus favorable pour effectuer une opération de parachutage : elle permet en effet aux équipages de disposer d’une assez bonne visibilité pour repérer le terrain de largage. Elle permet aussi aux avions de voler en formation, en restant assez près les uns des autres.Pendant ce temps, à Villelonge, la balise de guidage « Eurêka » a été installée au centre du terrain et son antenne de 3m50 déployée. Elle a été mise en œuvre par Raoul le Boucicaut en raison de sa formation radio et de sa fonction de chef de réception des parachutages. Raoul le Boucicaut a également réuni tout l’effectif de la compagnie YP (des Suchas et du Poulailler) ainsi que les maquisards désignés en renfort. Il a rappelé aux équipes de cinq les consignes que tous devront exécuter le plus rapidement possible.
Vers 1h00 du matin, à environ 80 km de Villelonge, le radio de l’avion de tête qui possède un transpondeur déclenche un signal codé qui active la balise «Eurêka ». Celle-ci envoie alors à son tour un signal qui va donner à l’avion le cap à suivre, ce qui facilite la tâche du navigateur, en lui évitant un certain nombre de calculs.
Un peu avant 1h30, les avions arrivent par le Nord-Est et entament leur descente. Ils passent au-dessus de Devesset et de Mars et se mettent à la recherche du terrain et de son balisage. Dans cette phase d’approche, ils sont pris directement en phonie par Virginia Hall qui s’est équipée de son S-Phone. Ce radiotéléphone UHF, fortement miniaturisé pour l’époque (mais 1kg 700 tout de même), est un peu l’ancêtre de nos téléphones portables : il permet de se mettre sur la fréquence radio de l’avion et de communiquer directement en clair avec lui. Les avions qui sont descendus à 200m d’altitude doivent faire deux passages : le premier pour repérer le terrain, le deuxième pour larguer leur cargaison. Ils décrivent une boucle au-dessus des Vastres et reviennent à nouveau en direction du Nord-Est. En allumant leurs feux de position, ils confirment ainsi qu’ils ont vu clignoter l’indicatif du terrain en morse (la lettre R). Au-dessus de la Suchère, ils virent à nouveau vers Villelonge (sortent le train d’atterrissage pour ralentir leur vitesse) et ouvrent les trappes des soutes à bombes. Dans le nez du B 17, l’observateur bombardier se tient prêt à donner le signal de largage. Au sol, dans le bruit des moteurs, tout le monde observe : les soutes ouvertes, les containers et les colis qui dégringolent avec les parachutes qui s’ouvrent. Il s’écoule 25 secondes avant que chaque container touche le sol. À l’arrivée au sol, les corolles des parachutes s’effondrent et le ramassage commence immédiatement.
Mais, un incident s’est produit : le pilote du premier avion n’a pas respecté la procédure et déversé toute sa cargaison sur le terrain de Devesset. Et ceci, car les maquisards ardéchois ont balisé leur terrain avec un éclairage surpuissant, réalisé avec des phares de voiture. Ce balisage est visible du ciel à une distance d’environ 30 km. (Pierre Fayol le saura plus tard grâce à des témoignages d’aviateurs). Entendant le bruit des avions, les maquisards présents à Devesset se sont dépêchés d’allumer le balisage de leur terrain. Voyant subitement s’illuminer devant lui un terrain aussi brillamment balisé, le pilote a sur le champ ordonné le largage. Il contacte d’ailleurs Virginia Hall à l’écoute sur son S-Phone et la félicite pour l’excellence de l’éclairage. C’est alors que Pierre Fayol, qui se trouve juste à côté de Diane, furieuse, entend la plus grosse bordée de jurons en langue anglaise qu’il n’a jamais entendu de sa vie.
Aussitôt, Bob part avec une équipe en camion (un vieux camion à gazogène), pour Devesset dans l’espoir de récupérer les containers. La manoeuvre à laquelle se sont livrés les maquisards de Devesset était très courante à l’époque. Si elle réussissait, elle permettait à un maquis de récupérer un parachutage ne lui étant pas destiné. Sauf que dans ce cas précis, il ne sera guère possible pour les maquisards de Devesset de revendiquer la propriété de la cargaison. En effet, les livraisons de matériel qu’ils reçoivent ne proviennent pas d’Angleterre mais d’Afrique du Nord et ne sont pas conditionnées dans des containers métalliques, mais dans des containers en carton toilé. À l’appui de cette preuve indiscutable en faveur de la compagnie YP s’en ajoute une autre : la BBC n’a pas diffusé le message : « Les poireaux sont longs et frisés », message annonçant un parachutage sur le terrain de Devesset. Cette phrase codée était parfaitement connue des maquisards de Villelonge et elle aurait dû être entendue le 11 juillet, or cela n’a pas été le cas.
Les trois avions se sont maintenant éloignés. Si tout va bien pour eux, ils seront de retour à leur base en Angleterre un peu avant cinq heures du matin. Chaque avion aura parcouru un total de1750 km (aller et retour) et chacun d’eux aura consommé, au bas mot, 6500 litres de carburant pour effectuer cette mission. (19 500 litres pour les trois avions).
À Villelonge, tout le monde s’affaire au ramassage. Les garçons de la compagnie YP aidés d’autres résistants rassemblent les containers et les colis en bordure du terrain, le long de la route départementale de Villelonge aux Vastres (la D7). Ils les chargent ensuite sur les chars et les tombereaux que les fermiers ont mis à la disposition des maquisards. Ils chargent également une « magnifique malle en osier » (je cite Pierre Fayol) remplie de matériel médical et destinée au service sanitaire. Il y a aussi dans ce parachutage un colis spécialement destiné à Virginia Hall qui contient une enveloppe de 1 million de Francs en billets (somme qui représenterait actuellement 250 000 Euros environ. Marianne Fayol et Jacqueline Decourdemanche quant à elles, se font rapporter tous les parachutes et les plient dans des sacs. Aux environs de 2h00 du matin, le ramassage est terminé.
Raoul Le Boulicaut a donné l’ordre de vérifier qu’aucun matériel compromettant n’ait été oublié sur le terrain. En effet, la consigne à respecter est la suivante : « Il ne doit rester aucune trace visible du parachutage ».
Les attelages de bœufs ou de vaches se mettent en route pour aller cacher leur chargement. Les containers et les colis seront stockés à Chaniaux, qui se trouve à peine à plus d’un kilomètre d’ici, ainsi que dans une vieille grange à l’Est du village de Villelonge, tout près d’ici. Le local où le boulanger Émile Valla (dit « Milou ») entrepose les fagots pour son fournil sert aussi de cache. Les parachutes, quant à eux, sont entreposés dans local fermé à clef, afin que des imprudents ne soient pas tentés de confectionner des chemises ou d’autres objets avec le tissu des parachutes, ce qui aurait pour conséquences non seulement l’arrestation de leur détenteur par la milice, mais aussi le déclenchement éventuel de représailles sur la population. Quelque temps après, le camion à gazogène envoyé à Devesset revient à Villelonge avec son chargement de containers récupérés, du moins la plus grande partie. Pour donner un ordre de grandeur, on peut estimer le nombre de containers qui seront cachés à une trentaine. On peut estimer aussi que les trois avions ont parachuté au total entre 6 et 7 tonnes de matériel, mais il est difficile d’être plus précis en matière de tonnages.
Le lendemain aura lieu la distribution et la répartition des armes, en fonction des besoins de chaque groupe, selon un plan établi par Pierre Fayol, en commençant par les trois compagnies de l’Yssingelais : Y1, Y2 et Y3. Toujours pour des raisons de sécurité, les containers vides seront précipités dans le gouffre de la Monette, à l’extrémité Sud-Est du terrain, à 1kilomètre d’ici. Il paraît qu’après la guerre, des pêcheurs pouvaient encore en voir des restes au fond de l’eau.
Il y aura ensuite 16 autres parachutages entre le 13 juillet et le 15 août sur le terrain de Villelonge, soit un rythme d’un parachutage tous les deux jours. Ces parachutages vont apporter beaucoup d’armes individuelles (dont les mythiques « mitraillettes » Sten anglaises ainsi que des carabines américaines US M1) et surtout énormément d’explosifs. Ils apportent aussi (on en a vu un exemple) de grosses sommes d’argent : des paquets de billets identiques à ceux de la Banque de France, mais imprimés par les Alliés, et placés dans des containers avec des marquages distinctifs.
La nuit du 14 au 15 août ce sont des personnels qui sont parachutés, à savoir une équipe « Jedburgh », (ayant pour nom de code : « Team Jeremy »), composée de trois hommes : le capitaine Geoffrey Mac Leod Hallowes (de l’armée britannique), le capitaine Henri Charles Gise (de l’armée française), et le sergent Roger Antony Leney (Anglais, avec fonction de radio). Ils sont réceptionnés par Désiré Zurbach et Alphonse Swartebroekx et logés chez madame Léa Jouve-Lebrat. Ils apportent avec eux 2 millions de Francs (500 000 Euros). Les équipes Jedburg étaient envoyées en France par l’OSS avec comme mission d’aider à l’instruction et à l’organisation des groupes de résistants. Elles étaient aussi chargées d’assurer la liaison entre la Résistance et les troupes alliées débarquées en France (en l’occurrence, celles débarquées en Provence le 15 août 1944).
Les parachutages postérieurs au 15 août 1944 sur Villelonge sont au nombre de trois et beaucoup plus espacés. Le 25 août 1944 sont parachutés dix officiers : quatre Américains, deux Britanniques et quatre Français. Dans la nuit du 4 au 5 septembre sont parachutés deux lieutenants américains, mais l’opération ne se déroule pas comme prévu (j’y reviendrai un peu plus loin). Le 11 septembre, a lieu le dernier parachutage sur ce terrain de Villelonge, effectué par un seul avion. Le 13, c’est le départ de Virginia Hall du Plateau avec son groupe de combattants (le corps franc « Diane »).
III) Une tentative de bilan : (des éléments de conclusion) quelle portée ont eu ces parachutages? Quelle valeur a cet exemple de Villelonge ?
Quelle est la portée historique et historiographique de ces parachutages de l’été 1944 sur le Plateau et de cet exemple de Villelonge ?
1°) La portée historique immédiate : le matériel parachuté (armes et explosifs) a contribué à la libération du département de la Haute-Loire de deux manières.
- Les explosifs ont permis d’effectuer plusieurs opérations de sabotage, en particulier celles prévues dans le cadre du plan « vert » pour paralyser le réseau ferroviaire. L’opération la plus spectaculaire est celle du 2 août 1944, à Chamalières-sur-Loire. Avec les explosifs, les résistants font sauter une partie du pont en pierre où passe la voie ferrée. A 100 m du pont, ils lancent une locomotive à vapeur et son tender qui vont aller s’encastrer dans la brèche créée par l’explosion, rendant totalement inutilisable la voie ferrée le Puy- St Etienne.
- Les armes ont permis d’équiper plusieurs maquis, dont ceux de l’Yssingelais. Les compagnies Y1 et Y2 vont ainsi participer d’une part à la libération du Puy, le 19 août 1944, et d’autre part aux combats qui aboutissent à la reddition de la colonne allemande en retraite à Estivareilles, le 22 août 1944. (La compagnie Y2 commandée par le capitaine Roger Ruel a pris une part importante aux combats autour de Craponne). La Haute-Loire se trouve donc libérée par les seules forces de la Résistance, bien avant l’arrivée des troupes alliées débarquées en Provence le 15 août 1944. En effet, les véhicules de la Première armée de De Lattre De Tassigny arrivent sur le Plateau, à Saint-Agrève, Le Chambon-sur-Lignon et Tence, dix jours plus tard, dans la nuit 1er au 2 septembre 1944).
2°) Une portée historiographique dans deux domaines :
- Tout d’abord concernant l’histoire des femmes dans la Résistance :
Le rôle des femmes dans la Résistance commence à être assez bien connu, mais il a été longtemps minimisé, voire invisibilisé. C’est pour éviter cet écueil que je voudrais apporter quelques précisions au sujet de Jacqueline Decourdemanche et Marianne Fayol. Je laisse le soin à Alice Mongour (qui va me succéder) de parler du rôle de Virginia Hall et de celui de Léa Jouve-Lebrat. Jacqueline Decourdemanche et Marianne Fayol ne se contentent pas de plier des parachutes et de tamponner des brassards à la pomme de terre, encore que ces seules activités leur vaudraient d’être arrêtées, torturées et fusillées en ces mois de juin juillet 1944. Aux côtés d’Oscar Rosowsky (dit : Jean-Claude Plunne »), elles participent toutes les deux à la fabrication et à l’attribution de faux papiers. Jacqueline Decourdemanche prend des risques énormes en convoyant Virginia Hall et son matériel depuis Cosne sur Loire dans la Nièvre jusqu’au Chambon-sur-Lignon. Marianne Fayol quant à elle s’occupe en tant qu’assistante sociale du service social d’aide au maquis pour le secteur d’Yssingeaux, puis pour tous les F.F.I. du département.
- Ensuite concernant un des axes actuels de la recherche sur les maquis en France.
Après la Libération, la France, mais aussi d’autres pays, ont mis en avant l’action de leur seule Résistance intérieure. Jusqu’à l’ouverture récente d’archives britanniques et américaines, la coopération entre les maquis et les services secrets alliés (le SOE anglais, l’OSS américaine) est restée pendant longtemps dans l’ombre, voire oubliée. De même l’attachement et les liens humains qui se sont créés entre les maquisards et les agents de ces différents services sont restés très peu évoqués. Or, on se rend compte que, les parachutages de l’été 1944 sur le Plateau, ainsi que l’exemple de Villelonge avec Virginia Hall et la compagnie YP, illustrent très concrètement cette coopération et cet attachement. Je renvoie les amateurs d’Histoire aux travaux de Raphaëlle Balu, dont la thèse « les maquis de France, la France libre et les Alliés (1943-1945) : retrouver la coopération » est l’objet d’un livre en cours de publication chez Perrin.
En guise d’épilogue : retour à la micro histoire ou l’histoire locale avec le parachutage dans la nuit du 4 au 5 septembre des deux lieutenants de l’armée américaine : Paul Goillot (dont la famille est française) et Henry Riley. Leur parachutage ne se déroule pas comme prévu : au lieu d’atterrir sur le terrain de Villelonge, ils touchent terre vingt kilomètres plus loin (à vol d’oiseau) à proximité du Mont Gerbier-de-Jonc. Deux explications à cela : d’une part l’équipage de l’avion n’a pas utilisé correctement le guidage par la balise Eurêka, et d’autre part, ils ont été déportés lors de leur saut par un vent relativement fort. En plus de leur mission qui est d’aider à l’instruction des maquisards, Henry Riley apporte avec lui la somme de deux millions de Francs (500 000 Euros). Ils sont d’abord hébergés chez Madame Léa Jouve-Lebrat puis seront ensuite logés dans la maison Girard de l’Armée du Salut à Roybet, où se trouve déjà Virginia Hall. Je laisse à Alice Mongour le soin de parler des suites de cette arrivée des deux lieutenants sur le Plateau. Je termine sur une anecdote : à la ferme du Roybet (la maison Girard), Paul Goillot et Henry Riley adoptent un petit chien, probablement pour donner l’alerte en cas de visite imprévue, et quel nom vont-ils donner à leur compagnon à quatre pattes ? Ils vont l’appeler : (cela ne s’invente pas …) « Parachute » !
Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je cède la parole à Alice Mongour.
Jean-Pierre VERROUL. Le 10 août 2024. (Journée de la Mémoire du 10 août 1942)